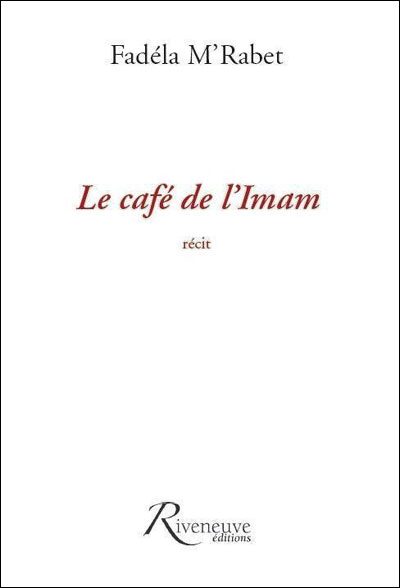Fadéla M’rabet est née à Skikda en 1936. Elle est élevée dans un milieu oulémiste, son père étant un proche ami de Ben Badis. Ce père, cultivé et éclairé, l’envoie en 1954 faire des études supérieures de sciences à Strasbourg. A Skikda, le père de Fadéla est le premier à envoyer ses filles à l’école. Docteur en biologie, Fadéla M’rabet a été maître de conférences et praticienne des hôpitaux à Broussais - Hôtel-Dieu (Paris).
Elle a publié deux livres retentissants La Femme algérienne (Maspéro, 1965) et Les Algériennes (Maspéro, 1967), alors qu’elle animait des émissions à la Chaîne III de la radio avec son mari Maurice Tarik Maschino de 1963 à 1967.
Elle publie aussiL’Algérie des illusions, en collaboration avec Maurice Tarik Maschino (R. Laffont, 1972) ; Une enfance singulière... en Algérie (éditions Balland, 2003, réédition ANEP) et Une femme d’ici et d’ailleurs.
Quand elle donne des conférences, il arrive que des femmes, mais aussi des hommes, viennent l’écouter avec à la main La Femme algérienne qu’elle a écrit en 1965 ou Les Algériennes (1967).
Fadéla M’rabet est une féministe de première heure. « Ma génération s’est battue pour la dignité, que ce soit en Algérie ou en France (...) A travers une émission de radio, j’ai tenté de donner la parole aux jeunes filles qui vivaient dans des conditions lamentables. Elles étaient soumises au mariage forcé. Leurs parents n’avaient jamais imaginé que leurs filles allaient mettre fin à leur vie. (...) Ceci a vraiment gêné le gouvernement de l’époque à tel point qu’on bloquait le courrier qui nous était adressé. J’ai même été convoquée par le ministre de l’Information de l’époque et il m’avait dit que j’étais trop impatiente et qu’il était prêt à sacrifier les femmes pour sauver la révolution », écrit Fadéla M’rabet dans Une Enfance singulière... en Algérie (éditions Balland, 2003).
Elle écrit aussi : « J’ai l’impression que depuis ma naissance, il y a 69 ans, je ne cesse d’entendre parler de la même chose, le voile, la polygamie, la répudiation (...) Le tutorat qu’on veut absolument conserver relève à mon sens du proxénétisme quand il concerne la femme majeure. »
Et d’ajouter dans le même livre autobiographique : « Il faut vraiment que les hommes nous méprisent pour inscrire notre nom dans une case du livret de famille avec, en attente d’être occupées, trois autres cases - comme autant de niches à lapines. Ou encore, pour décider du mari qui nous convient. »
Lynchage médiatique
Fadéla M’rabet a écrit La Femme algérienne (1965) et Les Algériennes (1967) à la suite des émissions qu’elle animait à la radio Chaîne III avec son mari, Maurice Tarik Maschino, militant de l’indépendance de l’Algérie.
Ils avaient trois émissions : « Cinq minutes d’histoire de l’Afrique », « Le magazine de la jeunesse » où les jeunes parlaient de leurs problèmes et une émission littéraire qui s’appelait « Des livres et des hommes ». Elle nous raconte : « Au bout d’un certain temps, surtout avec "le magazine de la jeunesse", on recevait beaucoup de lettres de filles qui m’appelaient à leur secours parce qu’on voulait les retirer de l’école pour les voiler et les marier. Des filles qui pensaient qu’il n’y avait pas d’autre échappatoire que le suicide. Il y avait beaucoup de suicides, alors que, jusque-là, ils étaient rares. L’indépendance avait fait espérer à ces jeunes filles qu’elles n’allaient pas continuer à vivre comme leur mère. Nos émissions avaient une audience considérable. Des journalistes étrangers en rendaient compte. Des médecins nous appelaient au chevet de celles qui rataient leur suicide et je me souviendrai toujours de cette fille qui était exsangue dans son lit, à l’hôpital, et son père qui ne cessait de lui répéter : "Ma fille tu nous as déshonorés". Devant cette accumulation de drames, je me serais sentie coupable de non-assistance à personnes en danger. Cela a été pour moi l’expression d’un cri pour venir au secours à toutes ces filles auxquelles on gâchait la vie, qu’on empêchait de vivre. »
A la sortie de ces deux livres, notamment le second, Fadéla M’rabet est l’objet d’un lynchage médiatique. Elle se rappelle : « On disait que j’incitais à la débauche, alors que je soutenais qu’on doit se libérer par la culture, par le travail, par l’instruction. »
Fadéla M’rabet est radiée en 1967 de son poste d’enseignante au lycée de garçons El Idrissi, elle a été ensuite réintégrée au lycée Frantz Fanon. Tarik, son mari, et elle n’avaient plus d’émission à la radio, ils ne pouvaient plus faire de reportages dans les journaux.« On ne pouvait plus s’exprimer. On voulait nous imposer une espèce de mort de la pensée. » Ils partent alors en France.
Pendant dix ans, Fadéla M’rabet n’est pas retournée en Algérie, n’ayant pu renouveler son passeport. En septembre 2003, elle a été invitée officiellement au Salon du livre d’Alger par la ministre de la Culture, Khalida Toumi. « J’ai été interviewée par la presse, la télévision, la radio. Cela fait plaisir d’être reconnue par les siens. »
« Un jour, nous serons libres »
Fadéla M’rabet s’insurge contre ce qu’on appelle les « valeurs arabo-islamiques » « sans jamais nous les définir ». « Est-ce que c’est une valeur de jeter une femme sur le trottoir ? Est-ce que c’est une valeur de spolier une femme de la moitié de l’héritage ? Est-ce une valeur la polygamie ? Est-ce une valeur de bafouer sans cesse la dignité de la femme ? », se demande-t-elle.
« Les valeurs arabo-islamiques, telles qu’elles m’ont été transmises, véhiculaient un art de vivre qui avait pour fondement l’humanité. Ce qui m’a été enseigné, ce ne sont pas des règles à respecter aveuglément, mais une façon de réagir en mon âme et conscience, seule, sans intermédiaire. »
Dans Une femme d’ici et d’ailleurs. La liberté est son pays, qui est sorti le 4 mars 2005 aux éditions de l’Aube, Fadéla M’rabet relève que « s’interroger, penser par soi-même, critiquer, c’est se mettre au ban de la société. S’exclure ... Chercher à être soi-même en se fondant sur son propre jugement peut conduire, en effet, à une autre conception du monde. Une conception moderne, scientifique, laïque. Qui distingue absolument le religieux du politique. Et ne conçoit pas que le religieux régisse, dans ses moindres détails, de la naissance à la mort, du lever du jour au coucher du soleil, la vie sociale, comme la vie privée. « Conception » diabolique, pour la plupart. Voilà pourquoi cette société figée empêche, ou tente d’empêcher, toute conscience singulière de se manifester, privilégie la tradition, et contraint chacun à l’observance la plus stricte de la loi : celle des ancêtres ».
« Un magnifique exemple de réalisation personnelle »
Sa grand-mère est le personnage central de son livre Une Enfance singulière.
Elle écrit : « Djedda m’insuffla le courage de me libérer. Veuve très jeune, elle n’a jamais voulu donner de beau-père à ses enfants. Du moins, c’est ce qu’elle disait. En tout cas, il nous était impossible d’imaginer cette force de la nature encombrée d’un mari. A ses côtés, il n’aurait été qu’un adversaire ou un nain. » (...) « Elle m’a donné un magnifique exemple de réalisation personnelle par l’activité sociale qui fut la sienne - la plus respectée de son époque : faire venir au monde des enfants. Non pas biologiquement, ce qui est à la portée de toute femme, mais par un savoir et un savoir-faire qui faisaient d’elle une grande prêtresse, une déesse de la maternité et de la vie. (...) Et moi qui ai vécu dans le milieu médical hiérarchisé, je peux dire que Djedda a eu plus de prestige qu’un mandarin de la faculté de médecine de Paris, parce que son travail était au service de la communauté, il était gratuit et désintéressé. » ... « C’est certainement la liberté d’esprit de Djedda qui m’a également permis d’assimiler deux cultures sans déchirements : je ne me suis jamais sentie écartelée entre deux mondes. » « Toute culture authentique est universelle. »
Elle nous raconte comment l’idée de ce livre lui est venue. En 1989, elle reçoit une invitation de féministes américaines qui voulaient l’inviter à un congrès international à Montréal et elles lui ont demandé de leur faire un exposé sur Simone de Beauvoir et le féminisme français. « J’ai répondu que malgré toute l’admiration que j’avais pour elle, Simone de Beauvoir n’était pas mon modèle féministe. J’ai proposé Djedda ma mémoire. Elles ont accepté. » Cette communication a débouché sur le livre Une enfance singulière... en Algérie.
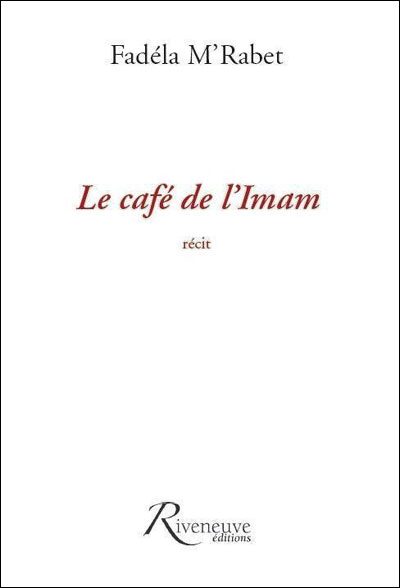
« Il n’y a pas de modèle préétabli »
Lorsqu’à la faveur d’un débat, des jeunes filles beurs lui demandent si elles doivent se comporter comme des Françaises ou comme des Algériennes, elle leur répond : « Vous devez vous comporter en votre âme et conscience, sans conformisme, partout. » « Parce que toute personne est singulière et enrichira ainsi son pays et toute l’humanité », nous dit-elle. « Il n’y a pas de prototype, de modèle préétabli. Et ces filles quand je leur disais cela, j’avais l’impression qu’elles étaient soulagées parce qu’enfin quelqu’un ne les met pas dans un carcan. En Algérie, c’est pareil. »
L’espoir
La situation actuelle de l’Algérie, elle l’évoque avec nous en reprenant cette scène décrite par l’écrivain Anouar Abdelmalek qui raconte dans un de ses livres qu’un soir, dans une rue d’Alger, il aperçoit au loin une petite lumière, vers laquelle il se dirige. Il voit une petite fille en train de faire ses devoirs sur le trottoir à la lumière d’une lampe électrique à côté de sa mère. « Au Salon du livre à Alger, des journalistes m’ont demandé si je voyais un espoir. L’image de cette petite fille est à la fois d’une tristesse infinie, mais d’une extrême beauté parce que tant qu’il y aura une petite fille qui, contre vents et marées, contre les inondations, les tremblements de terre, continue à faire ses devoirs, l’espoir est permis. Cela veut dire que l’Algérie restera toujours debout. »
En 1965, - le propos n’a pas pris une ride depuis tant il reste d’actualité - , Fadéla M’rabet écrivait en conclusion de La Femme algérienne : « Il en est de la libération des femmes comme de l’indépendance nationale : elle s’arrache. Les colonisés, les prolétaires qui se sont libérés ces dernières décennies, ne doivent qu’à eux-mêmes leur salut ; c’est grâce à leurs luttes que les femmes, ailleurs, ont conquis la plupart de leurs droits. »
In El Watan






 Faïza Guène, qui a connu un succès fulgurant après la sortie de son premier roman Kiffe Kiffe demain (sorti en 2004 et vendu à 400 000 exemplaires), écrit à 18 ans, revient, dans cet entretien, sur son roman en cours d’élaboration, sa résidence d’écriture à Aïn Témouchent (organisée par l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel), son rapport à la langue, à l’écriture et à ses origines algériennes.
Faïza Guène, qui a connu un succès fulgurant après la sortie de son premier roman Kiffe Kiffe demain (sorti en 2004 et vendu à 400 000 exemplaires), écrit à 18 ans, revient, dans cet entretien, sur son roman en cours d’élaboration, sa résidence d’écriture à Aïn Témouchent (organisée par l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel), son rapport à la langue, à l’écriture et à ses origines algériennes. 


 Pour ce faire, si l'on a conscience qu'aucun écrivain n'est assez grand, on ne peut a contrario douter que son art ne l'oblige spontanément, par sensibilité et par devoir, à reconstituer, point par point, les difficultés, les rancoeurs et les espérances de ceux qui, pour une seule petite seconde de vie hypothétique, tiennent le pari de s'offrir au péril. Partagé par leur douleur et leur vérité, l'écrivain responsable ne peut qu'essayer de les comprendre, de les ramener à l'espoir, non de les juger... En rapport avec ce qui nous intéresse ici, c'est un aspect fort de l'intention de l'écrivain qui est tout tracé dans l'épigraphe que Yasmina Khadra a placée en tête de son oeuvre: «Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir (Frantz Fanon, Les Damnés de la terre).»
Pour ce faire, si l'on a conscience qu'aucun écrivain n'est assez grand, on ne peut a contrario douter que son art ne l'oblige spontanément, par sensibilité et par devoir, à reconstituer, point par point, les difficultés, les rancoeurs et les espérances de ceux qui, pour une seule petite seconde de vie hypothétique, tiennent le pari de s'offrir au péril. Partagé par leur douleur et leur vérité, l'écrivain responsable ne peut qu'essayer de les comprendre, de les ramener à l'espoir, non de les juger... En rapport avec ce qui nous intéresse ici, c'est un aspect fort de l'intention de l'écrivain qui est tout tracé dans l'épigraphe que Yasmina Khadra a placée en tête de son oeuvre: «Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir (Frantz Fanon, Les Damnés de la terre).»